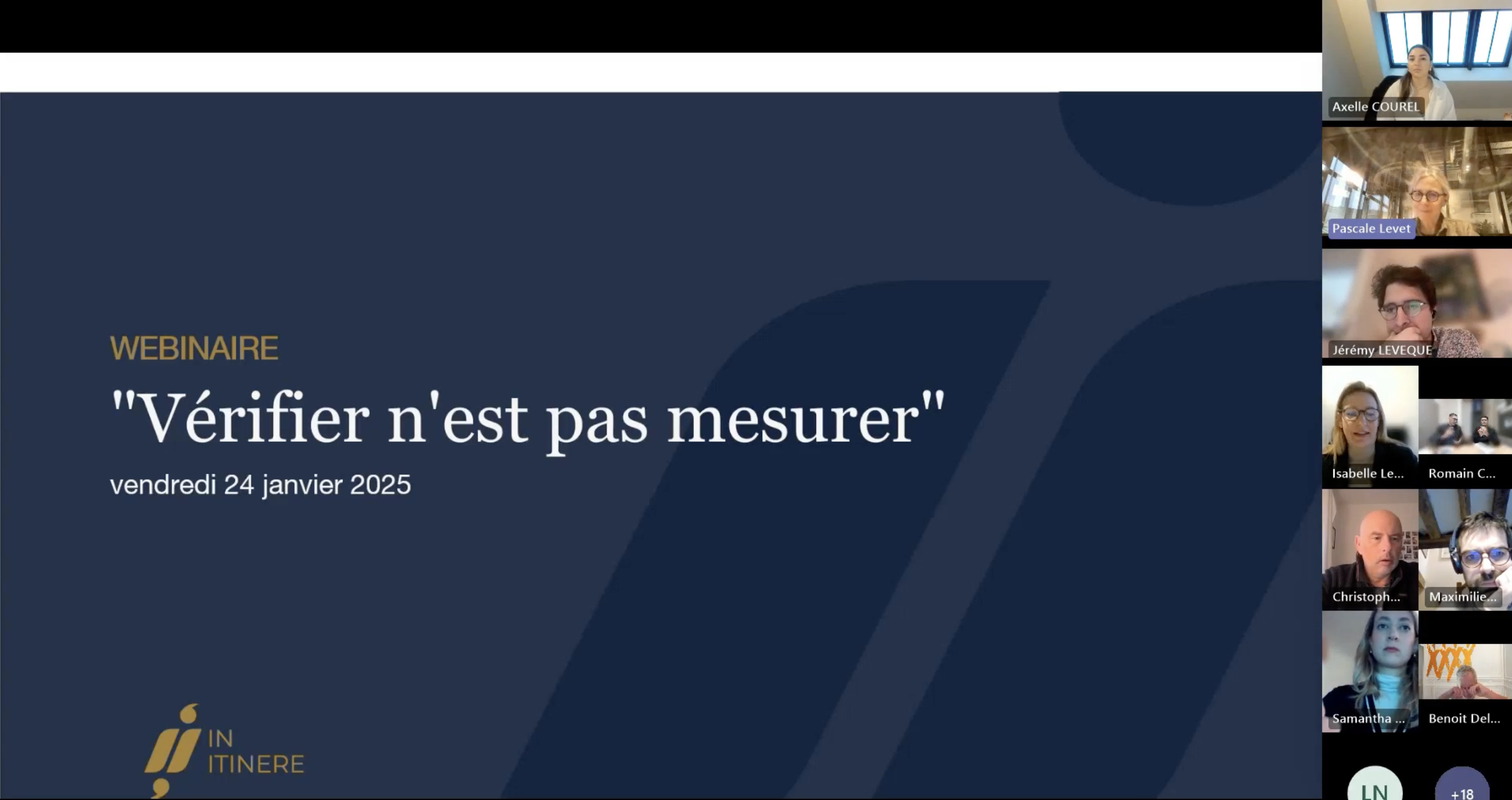
-> Revivez le webinaire sur la vérification apprenante !
IN ITINERE a fait le pari d’une vérification apprenante, conçue comme un levier de progression collective et un outil au service du caractère génératif des missions des sociétés. Entre intention et exécution, notre approche permet d’accompagner les entreprises dans la complexité de leur engagement.
Lors de notre webinaire, nous avons exploré ensemble les enjeux de la reddition et partagé des réflexions enrichies par vos expériences et questionnements. Vous avez été nombreux à nous faire confiance et à contribuer à cette discussion essentielle. Merci à vous !
📺 Pour consulter la rediffusion de notre webinaire et continuez à nourrir votre réflexion, contactez-nous.
Synthèse de nos intervenants
______________________________________
Jeremy LEVEQUE
Il ne faut pas laisser au jugement de chacun la connaissance de son devoir ;
il le lui faut prescrire, non pas le laisser choisir à son discours.
Montaigne, Essais, II.
Cette citation illustre la question du jugement, assez critique, que l’on porte sur les activités des entreprises, en cette période où elle est de plus en plus sommée de rendre des comptes sur ses actions.
Les tensions sont constitutives du dispositif de société à mission qui constitue à la fois un engagement formel, contraignant, et en même temps faire l’hypothèse que cet engagement est aussi un espace de liberté laissé à l’entreprise pour orienter ses choix de responsabilisation.
Quels sont les enseignements des travaux conduit à partir des pratiques des sociétés à mission sur l’effectivité de ce schéma de gouvernance, sur les écarts entre la promesse et le réel ?
______________________________________
Pascale Levet
«…Ce qui manque ne saurait être compté »
L’ecclésiaste, 1-15
Cette citation – extrait de citation -, illustre la tension entre quelque chose qui n’existe pas encore – on attend de la mission qu’elle puisse le faire advenir – et un exercice de vérification compris comme l’objectivation par la mesure d’un existant. Mais comme la mission est un « à venir », elle ne saurait être comptée… comme l’annonce ce webinaire, vérifier n’est pas mesurer.
Qu’est-ce que la capitalisation des missions de vérification nous enseigne du point de vue des démarches de vérification ?
______________________________________
François Cueille :
La signification d’une proposition, c’est sa méthode de vérification
Rudolph Carnap
Cette citation nous invite à répondre aux 2 questions suivantes s’agissant de l’entreprise à mission : Quelle est la signification de la société à mission ? et quelle méthode de vérification pourrait épouser cette signification ?
Details:
Speakers:
Jérémy Leveque, Pascale Levet, François CueilleWebsite:
initiere.frEvent Type:
BusinessOrganized By:
IN ITINERE

